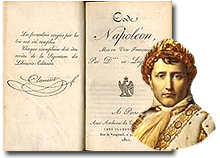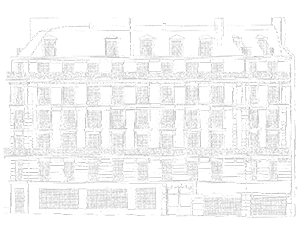Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
C’est toujours avec un plaisir non dissimulé que je réponds aux invitations de Madame Corinne Saint-Alary-Houin.
Non seulement parce que les travaux universitaires, qu’elle initie, sont toujours d’une excellente facture, grâce notamment aux talents variés et aux compétences croisées qu’elle sait réunir autour d’elle ; mais aussi, parce que je suis particulièrement honoré qu’elle demande à l’ancien étudiant, agitateur d’idées que je fus, et aujourd’hui, simple avocat que je suis d’intervenir dans cette enceinte.
A l’occasion du bicentenaire du code de commerce, je souhaiterais attirer votre attention sur les relations intimes qu’entretiennent le droit des affaires et le droit pénal, notamment dans le cas particulier du droit des procédures collectives.
En effet, certains commentateurs comparent souvent Nicolas Sarkozy à Napoléon Bonaparte. Pourtant, en ce qui concerne le droit commercial, tout les oppose.
En effet, alors que l’Empereur cherchait à combattre « les calculs de l’avidité et les spéculations de la mauvaise foi » en envoyant les faillis en prison, aujourd’hui le Président de la République déclare, devant l’université d’été du MEDEF, que la « pénalisation du droit des affaires est une grosse erreur ».
Je me garderai bien de dire lesquels des deux à raison tant la France de 2007 ne ressemble guère à celle de 1807.
Quoique.
Mais, restons sur le terrain balisé du droit.
Passerait-on d’un encadrement de la pratique commerciale très strict et laissant au commerçant une marge de manœuvre très étroite à une totale impunité du chef d’entreprise ?
Dans l’expectative d’une nouvelle législation en matière de droit pénal des affaires, je vous propose d’étudier la situation du commerçant en faillite à l’époque de Napoléon.
* ** *
« Nous avons assez de gloire, il nous faut des mœurs ».
Le cadre est posé, la législation du Code de Commerce de 1807 en matière de faillite et de banqueroute se devra d’affirmer une certaine sévérité.
Loi répressive entendue comme un « besoin public », elle a pour but de mettre fin aux abus venant concurrencer le travail et la bonne foi.
Ainsi, afin « d’encourager la probité », elle se doit de « secourir le malheur, corriger l’inconduite et punir le crime ».
On note ici une certaine gradation dans la définition des fautes et les peines à leur appliquer.
C’est en cela que le législateur se félicite de son apport vis-à-vis de la législation antérieure.
En effet, sous l’Ancien Régime, l’ordonnance de Colbert ne connaissait que « le malheur ou la friponnerie ».
Dans ce système, le malheur était présumé et la charge de la preuve de la fraude reposait sur les créanciers.
Or, les créanciers étaient généralement « plus occupés de sa propriété que de sa vengeance », la sévérité de la loi envers les débiteurs frauduleux était très peu appliquée.
Rien n’était alors plus « encourageant que cette impunité ».
L’œuvre de codification se fait donc dans le souci de mettre en place un système de défense efficace pour le créancier. Sans pour autant, toujours dans l’esprit du législateur de 1807, en arriver à considérer toute faillite comme un crime.
Aussi les législateurs gardent-ils à l’esprit que « très souvent, la faillite est un naufrage dont on ne peut accuser que le sort : le commerce a ses orages comme l’océan ».
Ainsi, cherchant un juste milieu entre le laxisme ancien et l’écueil d’une trop grande sévérité, ils en arrivent à la conclusion qu’il faut « considérer tout failli, non comme coupable, non comme un homme innocent, mais comme un débiteur dont la conduite exige un examen rigoureux et une solide garantie. »
Car il existe quoi qu’il en soit un délit, « puisqu’il y a eu violation d’engagements et de propriété ».
Celui qui a commis ce délit peut y avoir été conduit par le malheur, par l’inconduite, ou par la mauvaise foi. À circonstances différentes, mesures différentes.
C’est ainsi que le titre III du Code de Commerce sur les faillites et les banqueroutes est présenté par les codificateurs comme regroupant un ensemble de textes « sévères mais humains » répondant à un souci d’efficacité et d’équité.
La faillite est l’insolvabilité qui résulte du malheur. Le malheur doit être démontré par le failli et la loi « doit le protéger ».
La banqueroute est une insolvabilité dont le fait du débiteur est la cause. Il existe deux types de banqueroutes : celle qui est le résultat d’imprudence ou d’inconduite et celle qui résulte d’une fraude.
L’inconduite, ou banqueroute simple doit être prouvée par les créanciers ou le ministère public. Elle est du ressort du tribunal correctionnel. La sanction peut aller d’un mois à 2 ans de prison.
La fraude, quant à elle, est un crime et doit être « poursuivie par l’autorité » devant le tribunal criminel qui peut la punir de travaux forcés à temps (jusqu’à 30 ans).
Nous ne sommes pas loin de la Loi romaine des XII Tables qui prévoyait que le débiteur failli
pouvait être vendu comme esclave, trans tiberim, pour régler ses créanciers…
Dans tous les cas, le failli « ne doit plus disposer de l’administration de ses biens ; ils sont le gage et la propriété de ses créanciers ; il ne doit même avoir la liberté de sa personne que lorsque l’examen de sa conduite offre la présomption de son innocence. »
Ainsi le failli perd l’administration de ses biens, mais également ses dettes non échues deviennent exigibles ; il est suspendu de ses droits politiques ; il devient incapable d’exercer les fonctions d’agent de change ou de courtier, et même l’entrée de la bourse lui est interdite.
Enfin, et ce dans le cas du simple failli, celui qui n’a manqué que par malheur, « il a besoin de réhabilitation pour reprendre dans la société le rang dont ses malheurs l’ont privé ».
On peut d’ailleurs voir en cet idéal du failli le personnage de César Birotteau, exemple de « bêtise de la vertu », qui s’est tué à rembourser tous ses créanciers, alors que cela n’était pourtant pas l’usage.
« Tout cela est sévère, mais tout cela est juste à l’égard du failli », nous dit encore l’Empereur depuis un champ de bataille quelque part en Europe.
Ainsi, « le système adopté est fondé sur des motifs impérieux de justice et d’humanité ».
Justice envers le créancier, « humanité » envers le failli. Tel est l’esprit des codificateurs de 1807.
Pourtant, l’expérience a prouvé que l’esprit n’a pas été respecté et que le code de 1807 était trop rigide. Il paralysait la vie des affaires en laissant planer une menace démesurée.
C’est pourquoi, déjà sous la Restauration, la pratique développa déjà des concordats amiables et autres accords transactionnels pour éviter l’infamie d’une véritable procédure plus pénale que commerciale.
Que reste-t-il aujourd’hui des quatre objectifs érigés par le Code de commerce de 1807 :
Premièrement, « offrir aux créanciers une garantie solide, une protection active et surveillante, une certitude ou de terminer leurs affaires par un juste concordat, ou d’obtenir une prompte liquidation ».
Deuxièmement, « réprimer le luxe scandaleux et l’imprudence des spéculations hasardées, par la crainte du nom du banqueroutier et des peines correctionnelles appliquées à la banqueroute d’inconduite ».
Troisièmement, « assurer le châtiment de la mauvaise foi, et l’effrayer par d’utiles exemples ».
Quatrièmement enfin, « offrir à tout négociant honnête et malheureux les moyens de se tirer de la position incertaine et cruelle où l’ancienne législation le laissait, et conserver au moins son honneur en perdant sa fortune… ainsi, après qu’on ne lui ait trouvé la moindre cause de le conduire devant les tribunaux, il pourra exiger hautement l’estime et la pitié ».
Si Napoléon en militaire élevé à la dure école de Brienne était scandalisé par le luxe opulent que continuaient à afficher d’anciens faillis, il semble aujourd’hui que cela n’offusque plus personne.
Avez-vous entendu des critiques sur le fait que Bernard Tapie soit sur le point de négocier avec le gouvernement pour payer, aux frais des contribuables, l’intégralité de ses créanciers et récupérer au passage quelques petits millions d’euro ?
Comme dirait nos Anciens : o tempora, o mores.
Il est loin le temps où Napoléon décidait d’assister à quatre séances de discussion du Code de commerce au Conseil d’Etat, en réservant son énergie à trois séances pour le seul droit des faillites.
Indéniablement, il s’agissait d’un sujet qui le tenait à cœur et auquel il voulait apporter une réponse ferme et efficace afin de rétablir l’ordre dans le chaos juridique qui régnait en la matière au début du siècle.
Ainsi, outre la prison et le dessaisissement de la propriété de ses biens, il envisageait même de faire supporter à la femme le sort de son mari failli en la dépouillant de ses propres biens…
Aussi tint-il des propos extrêmement sévères envers le débiteur qui a cessé ses paiements.
Mais comme nous pouvons le constater dans l’analyse des dispositifs du Code de commerce 1807, le Conseil d’Etat a été moins dur que l’empereur et a atténué les dispositions du projet.
Enfin, une chose est certaine : depuis deux siècles, l’expérience a prouvé que s’il fallait séparer le sort de l’homme de celui de l’entreprise, il est dangereux de dé-responsabiliser le dirigeant.
En effet, cela entraîne un accroissement de l’aléa moral et les économistes et l’expérience, pour une fois d’accord, ont montré qu’une trop grande indifférence aux malheurs communs est la cause des soucis publics.
Le droit des faillites bancaires est là pour nous le rappeler et l’exemple de la crise financière des « subprimes » en est une malheureuse illustration.
Pour conclure, essayons de trouver la voie de la raison, sans parti pris, sans idéologie.
La solution ne réside ni dans tout le répressif, ni dans le laisser-faire.
Pour trouver le juste équilibre entre la dynamique du capitalisme chère à Fernand Braudel et la nécessaire régulation de l’économie de marché sans laquelle on assiste à des comportements aberrants et spoliateurs des plus faibles, je me demande si ce n’est pas à la pratique et aux juridictions de l’inventer, sous le regard attentif du ministère public…
Christophe Lèguevaques
Docteur en droit
Avocat
cLé réseau d’avocats
(Paris, Toulouse, Marseille)
L’auteur tient à remercier M. Jean-Philippe DUTEMPS, jeune et brillant étudiant de notre université, pour avoir contribuer à cette intervention.
C’est toujours avec un plaisir non dissimulé que je réponds aux invitations de Madame Corinne Saint-Alary-Houin.
Non seulement parce que les travaux universitaires, qu’elle initie, sont toujours d’une excellente facture, grâce notamment aux talents variés et aux compétences croisées qu’elle sait réunir autour d’elle ; mais aussi, parce que je suis particulièrement honoré qu’elle demande à l’ancien étudiant, agitateur d’idées que je fus, et aujourd’hui, simple avocat que je suis d’intervenir dans cette enceinte.
A l’occasion du bicentenaire du code de commerce, je souhaiterais attirer votre attention sur les relations intimes qu’entretiennent le droit des affaires et le droit pénal, notamment dans le cas particulier du droit des procédures collectives.
En effet, certains commentateurs comparent souvent Nicolas Sarkozy à Napoléon Bonaparte. Pourtant, en ce qui concerne le droit commercial, tout les oppose.
En effet, alors que l’Empereur cherchait à combattre « les calculs de l’avidité et les spéculations de la mauvaise foi » en envoyant les faillis en prison, aujourd’hui le Président de la République déclare, devant l’université d’été du MEDEF, que la « pénalisation du droit des affaires est une grosse erreur ».
Je me garderai bien de dire lesquels des deux à raison tant la France de 2007 ne ressemble guère à celle de 1807.
Quoique.
Mais, restons sur le terrain balisé du droit.
Passerait-on d’un encadrement de la pratique commerciale très strict et laissant au commerçant une marge de manœuvre très étroite à une totale impunité du chef d’entreprise ?
Dans l’expectative d’une nouvelle législation en matière de droit pénal des affaires, je vous propose d’étudier la situation du commerçant en faillite à l’époque de Napoléon.
* ** *
« Nous avons assez de gloire, il nous faut des mœurs ».
Le cadre est posé, la législation du Code de Commerce de 1807 en matière de faillite et de banqueroute se devra d’affirmer une certaine sévérité.
Loi répressive entendue comme un « besoin public », elle a pour but de mettre fin aux abus venant concurrencer le travail et la bonne foi.
Ainsi, afin « d’encourager la probité », elle se doit de « secourir le malheur, corriger l’inconduite et punir le crime ».
On note ici une certaine gradation dans la définition des fautes et les peines à leur appliquer.
C’est en cela que le législateur se félicite de son apport vis-à-vis de la législation antérieure.
En effet, sous l’Ancien Régime, l’ordonnance de Colbert ne connaissait que « le malheur ou la friponnerie ».
Dans ce système, le malheur était présumé et la charge de la preuve de la fraude reposait sur les créanciers.
Or, les créanciers étaient généralement « plus occupés de sa propriété que de sa vengeance », la sévérité de la loi envers les débiteurs frauduleux était très peu appliquée.
Rien n’était alors plus « encourageant que cette impunité ».
L’œuvre de codification se fait donc dans le souci de mettre en place un système de défense efficace pour le créancier. Sans pour autant, toujours dans l’esprit du législateur de 1807, en arriver à considérer toute faillite comme un crime.
Aussi les législateurs gardent-ils à l’esprit que « très souvent, la faillite est un naufrage dont on ne peut accuser que le sort : le commerce a ses orages comme l’océan ».
Ainsi, cherchant un juste milieu entre le laxisme ancien et l’écueil d’une trop grande sévérité, ils en arrivent à la conclusion qu’il faut « considérer tout failli, non comme coupable, non comme un homme innocent, mais comme un débiteur dont la conduite exige un examen rigoureux et une solide garantie. »
Car il existe quoi qu’il en soit un délit, « puisqu’il y a eu violation d’engagements et de propriété ».
Celui qui a commis ce délit peut y avoir été conduit par le malheur, par l’inconduite, ou par la mauvaise foi. À circonstances différentes, mesures différentes.
C’est ainsi que le titre III du Code de Commerce sur les faillites et les banqueroutes est présenté par les codificateurs comme regroupant un ensemble de textes « sévères mais humains » répondant à un souci d’efficacité et d’équité.
La faillite est l’insolvabilité qui résulte du malheur. Le malheur doit être démontré par le failli et la loi « doit le protéger ».
La banqueroute est une insolvabilité dont le fait du débiteur est la cause. Il existe deux types de banqueroutes : celle qui est le résultat d’imprudence ou d’inconduite et celle qui résulte d’une fraude.
L’inconduite, ou banqueroute simple doit être prouvée par les créanciers ou le ministère public. Elle est du ressort du tribunal correctionnel. La sanction peut aller d’un mois à 2 ans de prison.
La fraude, quant à elle, est un crime et doit être « poursuivie par l’autorité » devant le tribunal criminel qui peut la punir de travaux forcés à temps (jusqu’à 30 ans).
Nous ne sommes pas loin de la Loi romaine des XII Tables qui prévoyait que le débiteur failli
pouvait être vendu comme esclave, trans tiberim, pour régler ses créanciers…
Dans tous les cas, le failli « ne doit plus disposer de l’administration de ses biens ; ils sont le gage et la propriété de ses créanciers ; il ne doit même avoir la liberté de sa personne que lorsque l’examen de sa conduite offre la présomption de son innocence. »
Ainsi le failli perd l’administration de ses biens, mais également ses dettes non échues deviennent exigibles ; il est suspendu de ses droits politiques ; il devient incapable d’exercer les fonctions d’agent de change ou de courtier, et même l’entrée de la bourse lui est interdite.
Enfin, et ce dans le cas du simple failli, celui qui n’a manqué que par malheur, « il a besoin de réhabilitation pour reprendre dans la société le rang dont ses malheurs l’ont privé ».
On peut d’ailleurs voir en cet idéal du failli le personnage de César Birotteau, exemple de « bêtise de la vertu », qui s’est tué à rembourser tous ses créanciers, alors que cela n’était pourtant pas l’usage.
« Tout cela est sévère, mais tout cela est juste à l’égard du failli », nous dit encore l’Empereur depuis un champ de bataille quelque part en Europe.
Ainsi, « le système adopté est fondé sur des motifs impérieux de justice et d’humanité ».
Justice envers le créancier, « humanité » envers le failli. Tel est l’esprit des codificateurs de 1807.
Pourtant, l’expérience a prouvé que l’esprit n’a pas été respecté et que le code de 1807 était trop rigide. Il paralysait la vie des affaires en laissant planer une menace démesurée.
C’est pourquoi, déjà sous la Restauration, la pratique développa déjà des concordats amiables et autres accords transactionnels pour éviter l’infamie d’une véritable procédure plus pénale que commerciale.
Que reste-t-il aujourd’hui des quatre objectifs érigés par le Code de commerce de 1807 :
Premièrement, « offrir aux créanciers une garantie solide, une protection active et surveillante, une certitude ou de terminer leurs affaires par un juste concordat, ou d’obtenir une prompte liquidation ».
Deuxièmement, « réprimer le luxe scandaleux et l’imprudence des spéculations hasardées, par la crainte du nom du banqueroutier et des peines correctionnelles appliquées à la banqueroute d’inconduite ».
Troisièmement, « assurer le châtiment de la mauvaise foi, et l’effrayer par d’utiles exemples ».
Quatrièmement enfin, « offrir à tout négociant honnête et malheureux les moyens de se tirer de la position incertaine et cruelle où l’ancienne législation le laissait, et conserver au moins son honneur en perdant sa fortune… ainsi, après qu’on ne lui ait trouvé la moindre cause de le conduire devant les tribunaux, il pourra exiger hautement l’estime et la pitié ».
Si Napoléon en militaire élevé à la dure école de Brienne était scandalisé par le luxe opulent que continuaient à afficher d’anciens faillis, il semble aujourd’hui que cela n’offusque plus personne.
Avez-vous entendu des critiques sur le fait que Bernard Tapie soit sur le point de négocier avec le gouvernement pour payer, aux frais des contribuables, l’intégralité de ses créanciers et récupérer au passage quelques petits millions d’euro ?
Comme dirait nos Anciens : o tempora, o mores.
Il est loin le temps où Napoléon décidait d’assister à quatre séances de discussion du Code de commerce au Conseil d’Etat, en réservant son énergie à trois séances pour le seul droit des faillites.
Indéniablement, il s’agissait d’un sujet qui le tenait à cœur et auquel il voulait apporter une réponse ferme et efficace afin de rétablir l’ordre dans le chaos juridique qui régnait en la matière au début du siècle.
Ainsi, outre la prison et le dessaisissement de la propriété de ses biens, il envisageait même de faire supporter à la femme le sort de son mari failli en la dépouillant de ses propres biens…
Aussi tint-il des propos extrêmement sévères envers le débiteur qui a cessé ses paiements.
Mais comme nous pouvons le constater dans l’analyse des dispositifs du Code de commerce 1807, le Conseil d’Etat a été moins dur que l’empereur et a atténué les dispositions du projet.
Enfin, une chose est certaine : depuis deux siècles, l’expérience a prouvé que s’il fallait séparer le sort de l’homme de celui de l’entreprise, il est dangereux de dé-responsabiliser le dirigeant.
En effet, cela entraîne un accroissement de l’aléa moral et les économistes et l’expérience, pour une fois d’accord, ont montré qu’une trop grande indifférence aux malheurs communs est la cause des soucis publics.
Le droit des faillites bancaires est là pour nous le rappeler et l’exemple de la crise financière des « subprimes » en est une malheureuse illustration.
Pour conclure, essayons de trouver la voie de la raison, sans parti pris, sans idéologie.
La solution ne réside ni dans tout le répressif, ni dans le laisser-faire.
Pour trouver le juste équilibre entre la dynamique du capitalisme chère à Fernand Braudel et la nécessaire régulation de l’économie de marché sans laquelle on assiste à des comportements aberrants et spoliateurs des plus faibles, je me demande si ce n’est pas à la pratique et aux juridictions de l’inventer, sous le regard attentif du ministère public…
Christophe Lèguevaques
Docteur en droit
Avocat
cLé réseau d’avocats
(Paris, Toulouse, Marseille)
L’auteur tient à remercier M. Jean-Philippe DUTEMPS, jeune et brillant étudiant de notre université, pour avoir contribuer à cette intervention.
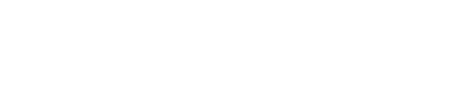
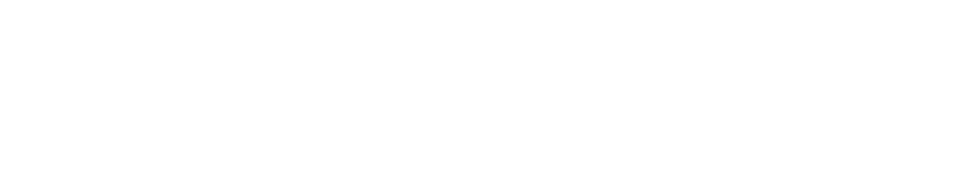

 Un avocat ?
Un avocat ?